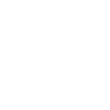Les aventures de Rafale
Les activités humaines et leurs impacts sur l’écosystème | Les aires marines protégées : une solution à privilégier | Pour en apprendre davantage
La chaîne de la vie : un réseau en harmonie
Une fois nos bagages à l’hôtel, tante Mélodie et moi sommes partis vers la côte. Il paraît qu’il y a là des océanographes qui font des recherches.
![]() Tante Mélodie, que font ces gens au juste?
Tante Mélodie, que font ces gens au juste?
![]() Ils recueillent des spécimens de phytoplancton.
Ils recueillent des spécimens de phytoplancton.
![]() Des quoi?
Des quoi?
![]() Des algues planctoniques, qu’on appelle aussi
« phytoplancton ».
Des algues planctoniques, qu’on appelle aussi
« phytoplancton ».
![]() Moi, je ne vois que de l’eau dans leurs contenants.
Moi, je ne vois que de l’eau dans leurs contenants.
![]() Tu sais, Rafale, la vie ne s’arrête pas à ce que tu peux
observer à l’œil nu. Le phytoplancton est une algue minuscule considérée comme
la plus petite forme de plante sur terre. Il est constitué d’une seule cellule, ce qui fait qu’il est difficile à
voir sans microscope. Cependant, dans les endroits où il est en abondance, l’eau
prend une couleur verdâtre à cause de la
chlorophylle
qu’il contient. Comme toutes les autres plantes
vertes, le phytoplancton a besoin de soleil pour vivre et pour produire la
photosynthèse. C’est pourquoi il se
retrouve dans la couche d’eau de surface où la lumière peut l’atteindre. Il
n’est donc pas fixé au fond, puisqu’il n’a pas d’organe lui permettant de
l’être, et il flotte au gré des courants qui le transportent.
Tu sais, Rafale, la vie ne s’arrête pas à ce que tu peux
observer à l’œil nu. Le phytoplancton est une algue minuscule considérée comme
la plus petite forme de plante sur terre. Il est constitué d’une seule cellule, ce qui fait qu’il est difficile à
voir sans microscope. Cependant, dans les endroits où il est en abondance, l’eau
prend une couleur verdâtre à cause de la
chlorophylle
qu’il contient. Comme toutes les autres plantes
vertes, le phytoplancton a besoin de soleil pour vivre et pour produire la
photosynthèse. C’est pourquoi il se
retrouve dans la couche d’eau de surface où la lumière peut l’atteindre. Il
n’est donc pas fixé au fond, puisqu’il n’a pas d’organe lui permettant de
l’être, et il flotte au gré des courants qui le transportent.
![]() J’avoue que cette algue est spéciale, mais pourquoi
s’intéresse-t-on autant à une si petite plante?
J’avoue que cette algue est spéciale, mais pourquoi
s’intéresse-t-on autant à une si petite plante?
![]() Si
petite soit-elle, cette algue est la base même de la chaîne alimentaire
marine. Son existence et sa survie ont une incidence sur tous les organismes
du golfe du Saint-Laurent, du tout petit zooplancton au plus gros des
poissons. Même les mammifères marins et les oiseaux en dépendent!
Si
petite soit-elle, cette algue est la base même de la chaîne alimentaire
marine. Son existence et sa survie ont une incidence sur tous les organismes
du golfe du Saint-Laurent, du tout petit zooplancton au plus gros des
poissons. Même les mammifères marins et les oiseaux en dépendent!
![]() Mais tante Mélodie! Peux-tu m’expliquer ce qu’est la chaîne
alimentaire?
Mais tante Mélodie! Peux-tu m’expliquer ce qu’est la chaîne
alimentaire?
![]() C’est une chaîne où chaque élément a son importance. En fait, toute espèce se
nourrit d’une autre espèce végétale ou animale plus petite qu’elle. Ainsi, les
végétaux sont mangés par les herbivores, qui sont mangés par des carnivores, qui
à leur tour servent de nourriture à de plus grands carnivores. Pour être plus
précise, les herbivores se nourrissent de plantes, de fruits et de légumes,
tandis que les carnivores mangent de la viande, c’est-à-dire d’autres animaux.
Il existe aussi des omnivores qui, eux, mangent à la fois des végétaux et des
animaux, puis des insectivores qui se nourrissent d’insectes.
C’est une chaîne où chaque élément a son importance. En fait, toute espèce se
nourrit d’une autre espèce végétale ou animale plus petite qu’elle. Ainsi, les
végétaux sont mangés par les herbivores, qui sont mangés par des carnivores, qui
à leur tour servent de nourriture à de plus grands carnivores. Pour être plus
précise, les herbivores se nourrissent de plantes, de fruits et de légumes,
tandis que les carnivores mangent de la viande, c’est-à-dire d’autres animaux.
Il existe aussi des omnivores qui, eux, mangent à la fois des végétaux et des
animaux, puis des insectivores qui se nourrissent d’insectes.
![]() Ouf!
Et nous, les humains, où sommes-nous là-dedans?
Ouf!
Et nous, les humains, où sommes-nous là-dedans?
![]() Les humains, qui sont pour la plupart des omnivores, sont au
sommet de la chaîne alimentaire.
Les humains, qui sont pour la plupart des omnivores, sont au
sommet de la chaîne alimentaire.
![]() On
est sauf, alors!
On
est sauf, alors!
![]() Oui, on peut dire cela, mais l’humain doit faire attention de
ne pas perturber l’harmonie de ce réseau. Dans la nature, cette chaîne permet un
certain équilibre entre les espèces, en contrôlant leur taux de reproduction et
de mortalité. Par exemple, s’il n’y avait pas de carnivores, les herbivores
finiraient par être trop nombreux et cela entraînerait un manque de végétaux.
Privés de nourriture, les herbivores disparaîtraient à leur tour.
Oui, on peut dire cela, mais l’humain doit faire attention de
ne pas perturber l’harmonie de ce réseau. Dans la nature, cette chaîne permet un
certain équilibre entre les espèces, en contrôlant leur taux de reproduction et
de mortalité. Par exemple, s’il n’y avait pas de carnivores, les herbivores
finiraient par être trop nombreux et cela entraînerait un manque de végétaux.
Privés de nourriture, les herbivores disparaîtraient à leur tour.
![]() Comment les humains peuvent-ils perturber cette harmonie?
Comment les humains peuvent-ils perturber cette harmonie?
![]() De
plusieurs façons. Par exemple, s’ils surconsomment certaines espèces, ils
les mettent en danger et dérangent le fragile équilibre de la chaîne
alimentaire. La disparition d’une espèce cause souvent la perte d’une autre
qui dépendait d’elle pour se nourrir, et cela peut entraîner une réaction en
chaîne.
De
plusieurs façons. Par exemple, s’ils surconsomment certaines espèces, ils
les mettent en danger et dérangent le fragile équilibre de la chaîne
alimentaire. La disparition d’une espèce cause souvent la perte d’une autre
qui dépendait d’elle pour se nourrir, et cela peut entraîner une réaction en
chaîne.
![]() Mais il faut faire quelque chose pour empêcher cela!
Mais il faut faire quelque chose pour empêcher cela!
![]() Quelques
mesures sont déjà prises. Par exemple, on interdit la chasse ou la pêche de
certaines espèces pour leur laisser le temps de se repeupler. Toutefois, le
plus important est de toujours rester vigilant pour ne pas surconsommer les
espèces prisées pour la consommation humaine.
Quelques
mesures sont déjà prises. Par exemple, on interdit la chasse ou la pêche de
certaines espèces pour leur laisser le temps de se repeupler. Toutefois, le
plus important est de toujours rester vigilant pour ne pas surconsommer les
espèces prisées pour la consommation humaine.
![]() Je comprends! Maintenant, tante Mélodie, parle-moi de la
chaîne alimentaire propre au golfe du Saint-Laurent.
Je comprends! Maintenant, tante Mélodie, parle-moi de la
chaîne alimentaire propre au golfe du Saint-Laurent.
![]() D’accord, mais je dois commencer par te parler des
différentes espèces qui la composent.
D’accord, mais je dois commencer par te parler des
différentes espèces qui la composent.
![]() OK!
Parfait!
OK!
Parfait!
![]() D’abord, je dois te dire que les spécialistes ont divisé les
organismes qui vivent dans le golfe du Saint-Laurent en sept catégories
différentes. Il y a les macrophytes, le plancton, la communauté
benthique, les reptiles, les poissons, les oiseaux et
les mammifères marins.
D’abord, je dois te dire que les spécialistes ont divisé les
organismes qui vivent dans le golfe du Saint-Laurent en sept catégories
différentes. Il y a les macrophytes, le plancton, la communauté
benthique, les reptiles, les poissons, les oiseaux et
les mammifères marins.
![]() Un macrophyte! Mais qu’est-ce que c’est!
Un macrophyte! Mais qu’est-ce que c’est!
![]() Les
macrophytes sont des végétaux qui servent surtout d’abris aux petits
organismes marins. Il en existe deux sortes : les macroalgues et les plantes
vasculaires marines. Les macroalgues, qui sont brunes, vertes ou rouges,
n’ont pas de racines et elles flottent dans l’eau en se laissant porter par
les courants. En plus de protéger les petits organismes contre les
prédateurs et les trop forts rayons du soleil, elles sont une source de
nourriture pour les petites espèces marines comme l’oursin. Quant aux
plantes vasculaires marines, aussi appelées « herbes marines », elles ont
des racines et elles contribuent à empêcher le sol de s’éroder et de se
dégrader. En plus de fournir un abri et de la nourriture aux petites
espèces, elles améliorent la qualité de l’eau et elles sont une source de
carbone, un gaz nécessaire à la survie de la
faune et de la
flore
marines.
Les
macrophytes sont des végétaux qui servent surtout d’abris aux petits
organismes marins. Il en existe deux sortes : les macroalgues et les plantes
vasculaires marines. Les macroalgues, qui sont brunes, vertes ou rouges,
n’ont pas de racines et elles flottent dans l’eau en se laissant porter par
les courants. En plus de protéger les petits organismes contre les
prédateurs et les trop forts rayons du soleil, elles sont une source de
nourriture pour les petites espèces marines comme l’oursin. Quant aux
plantes vasculaires marines, aussi appelées « herbes marines », elles ont
des racines et elles contribuent à empêcher le sol de s’éroder et de se
dégrader. En plus de fournir un abri et de la nourriture aux petites
espèces, elles améliorent la qualité de l’eau et elles sont une source de
carbone, un gaz nécessaire à la survie de la
faune et de la
flore
marines.
![]() Ces végétaux sont vraiment utiles!
Ces végétaux sont vraiment utiles!
![]() Oui, en effet!
Oui, en effet!
![]() Et le plancton, lui! J’imagine que le phytoplancton
appartient à cette catégorie.
Et le plancton, lui! J’imagine que le phytoplancton
appartient à cette catégorie.
![]() Tu as tout à fait raison, Rafale! Le phytoplancton fait
partie de la catégorie du plancton, mais il n’est pas le seul. Les
spécialistes dénombrent environ 500 espèces différentes dans ce groupe!
Tu as tout à fait raison, Rafale! Le phytoplancton fait
partie de la catégorie du plancton, mais il n’est pas le seul. Les
spécialistes dénombrent environ 500 espèces différentes dans ce groupe!
![]() Géant!
Géant!
![]() Oui! Mais les deux sous-groupes les plus importants sont le
phytoplancton et le zooplancton. Le phytoplancton est l’ensemble végétal du
plancton, tandis que le zooplancton est son ensemble animal. Minuscules, les
deux espèces flottent dans l’eau et se déplacent au gré des courants, mais le
phytoplancton sert de nourriture au zooplancton. Enfin, il existe différentes
sortes de zooplanctons, mais les plus connus sont les copépodes, le krill et les
protozoaires.
Oui! Mais les deux sous-groupes les plus importants sont le
phytoplancton et le zooplancton. Le phytoplancton est l’ensemble végétal du
plancton, tandis que le zooplancton est son ensemble animal. Minuscules, les
deux espèces flottent dans l’eau et se déplacent au gré des courants, mais le
phytoplancton sert de nourriture au zooplancton. Enfin, il existe différentes
sortes de zooplanctons, mais les plus connus sont les copépodes, le krill et les
protozoaires.
![]() Incroyable!
Je n’aurais jamais pensé que des animaux aussi petits pouvaient exister! La
communauté benthique est-elle petite aussi?
Incroyable!
Je n’aurais jamais pensé que des animaux aussi petits pouvaient exister! La
communauté benthique est-elle petite aussi?
![]() Oui et non! En fait, même si elle regroupe aussi de très petits organismes,
la plupart d’entre eux sont plus facilement visibles à l’œil nu.
Oui et non! En fait, même si elle regroupe aussi de très petits organismes,
la plupart d’entre eux sont plus facilement visibles à l’œil nu.
![]() Donc,
cette communauté rassemble plusieurs sortes d’espèces marines.
Donc,
cette communauté rassemble plusieurs sortes d’espèces marines.
![]() Oui!
De toutes les catégories, c’est la communauté benthique qui est la plus
nombreuse. Dans le golfe du Saint-Laurent, le nombre d’espèces qui en fait
partie est estimé à 3 000 et les scientifiques en découvrent sans cesse de
nouvelles!
Oui!
De toutes les catégories, c’est la communauté benthique qui est la plus
nombreuse. Dans le golfe du Saint-Laurent, le nombre d’espèces qui en fait
partie est estimé à 3 000 et les scientifiques en découvrent sans cesse de
nouvelles!
![]() 3 000!
C’est énorme!
3 000!
C’est énorme!
![]() Oui,
effectivement! Et cette communauté, qui représente un éventail d’organismes
qui vivent dans les fonds marins, est aussi divisée en sous-catégories. Il y
en a trois principales : celle du macrobenthos, celle des macroinvertébrés
et celle de la microfaune et de la méiofaune.
Oui,
effectivement! Et cette communauté, qui représente un éventail d’organismes
qui vivent dans les fonds marins, est aussi divisée en sous-catégories. Il y
en a trois principales : celle du macrobenthos, celle des macroinvertébrés
et celle de la microfaune et de la méiofaune.
![]() Je
n’avais jamais entendu ces noms auparavant. Ils sont bizarres!
Je
n’avais jamais entendu ces noms auparavant. Ils sont bizarres!
![]() Tu
as bien raison, mais ces catégories regroupent des espèces qui ont des noms
qui te seront sûrement plus familiers! Le groupe du macrobenthos, par
exemple, est composé de crustacés, comme le homard, le crabe et la crevette.
Il est aussi composé de mollusques, comme l’huître et la moule, et
d’échinodermes, comme l’étoile de mer.
Tu
as bien raison, mais ces catégories regroupent des espèces qui ont des noms
qui te seront sûrement plus familiers! Le groupe du macrobenthos, par
exemple, est composé de crustacés, comme le homard, le crabe et la crevette.
Il est aussi composé de mollusques, comme l’huître et la moule, et
d’échinodermes, comme l’étoile de mer.
Crabe commun

Tammy Bellefleur, © Le Québec en images, CCDMD
Étoile de mer commune

Source : © Rodolph Balej
La classe des macroinvertébrés, elle, est formée en majorité d’annélides, c’est-à-dire de vers marins, mais elle se compose aussi d’éponges et de cnidaires, comme les coraux et les anémones, ainsi que d’autres petits animaux, comme les vers plats.
Enfin, la sous-catégorie regroupant la microfaune et la méiofaune est constituée de microcrustacés, c’est-à-dire de petits organismes qui aident à recycler les nutriments en mangeant les excréments des autres animaux marins.
Anémone plumeuse (blanche)
(aussi appelée « œillet de mer »)

Source : Image modifiée,© Rodolph Balej
![]() Peuh!
Peuh!
![]() C’est
vrai que, dit ainsi, ça peut sembler un peu dégoûtant! Mais ce recyclage des
nutriments est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème marin. J’ai
oublié de te le mentionner plus tôt lorsque je te parlais des herbivores et
des carnivores, mais il existe aussi une autre espèce d’animaux : les
détritivores. Ceux-ci se nourrissent de matières organiques en
décomposition. Les petits organismes de la microfaune et de la méiofaune
font partie de cette catégorie.
C’est
vrai que, dit ainsi, ça peut sembler un peu dégoûtant! Mais ce recyclage des
nutriments est nécessaire au bon fonctionnement de l’écosystème marin. J’ai
oublié de te le mentionner plus tôt lorsque je te parlais des herbivores et
des carnivores, mais il existe aussi une autre espèce d’animaux : les
détritivores. Ceux-ci se nourrissent de matières organiques en
décomposition. Les petits organismes de la microfaune et de la méiofaune
font partie de cette catégorie.
![]() J’imagine que, de cette manière, il n’y a pas de gaspillage!
J’imagine que, de cette manière, il n’y a pas de gaspillage!
![]() Tu as tout compris!
Tu as tout compris!
![]() Maintenant,
dis-moi, les reptiles, eux, sont-ils nombreux? Est-ce que je pourrais
rencontrer un crocodile?
Maintenant,
dis-moi, les reptiles, eux, sont-ils nombreux? Est-ce que je pourrais
rencontrer un crocodile?
![]() Ha!
Ha! Ha! Non, Rafale! Je suis désolée de te décevoir, mais il n’y pas de
crocodiles dans le golfe du Saint-Laurent. Le seul reptile que l’on peut y
voir est la tortue luth. Selon les spécialistes, elle viendrait s’y
installer durant l’été, parce qu’elle y retrouve son aliment préféré : la
méduse!
Ha!
Ha! Ha! Non, Rafale! Je suis désolée de te décevoir, mais il n’y pas de
crocodiles dans le golfe du Saint-Laurent. Le seul reptile que l’on peut y
voir est la tortue luth. Selon les spécialistes, elle viendrait s’y
installer durant l’été, parce qu’elle y retrouve son aliment préféré : la
méduse!
![]() Tant
mieux alors! J’aime mieux me retrouver face à face avec une tortue qu’avec
un crocodile!
Tant
mieux alors! J’aime mieux me retrouver face à face avec une tortue qu’avec
un crocodile!
![]() Je
te comprends! Moi aussi! Malheureusement, étant donné que cette tortue est
considérée comme étant en voie de disparition, nos chances de la voir sont
plutôt minces.
Je
te comprends! Moi aussi! Malheureusement, étant donné que cette tortue est
considérée comme étant en voie de disparition, nos chances de la voir sont
plutôt minces.
![]() Ah non! Pourquoi n’arrête-t-on pas de la chasser, alors?
Ah non! Pourquoi n’arrête-t-on pas de la chasser, alors?
![]() Le
problème, ce n’est pas qu’elle soit chassée. Ce qui la met en danger, ce
sont les filets de pêche et les déchets qui flottent sur l’eau. La pauvre
finit souvent par se noyer lorsqu’elle se prend dans ces cordages et par
s’étouffer lorsqu’elle confond ces déchets avec sa nourriture.
Le
problème, ce n’est pas qu’elle soit chassée. Ce qui la met en danger, ce
sont les filets de pêche et les déchets qui flottent sur l’eau. La pauvre
finit souvent par se noyer lorsqu’elle se prend dans ces cordages et par
s’étouffer lorsqu’elle confond ces déchets avec sa nourriture.
![]() C’est
vraiment trop triste! Il faut faire quelque chose pour la sauver!
C’est
vraiment trop triste! Il faut faire quelque chose pour la sauver!
![]() Il
y a des moyens qui seraient certainement efficaces. Je t’en reparlerai
tantôt, mais d’abord, je voudrais finir de t’énumérer les espèces qui vivent
dans le Saint-Laurent.
Il
y a des moyens qui seraient certainement efficaces. Je t’en reparlerai
tantôt, mais d’abord, je voudrais finir de t’énumérer les espèces qui vivent
dans le Saint-Laurent.
![]() OK,
d’accord! Quelle est la prochaine espèce?
OK,
d’accord! Quelle est la prochaine espèce?
![]() La
prochaine, c’est la grande famille des poissons!
La
prochaine, c’est la grande famille des poissons!
![]() Il
doit y en avoir beaucoup!
Il
doit y en avoir beaucoup!
![]() Oui!
C’est pourquoi je ne t’énumérerai que les espèces les plus importantes.
Oui!
C’est pourquoi je ne t’énumérerai que les espèces les plus importantes.
![]() Ça me va!
Ça me va!
![]() D'abord, tu dois savoir que les différentes espèces de poissons de mer qui
vivent dans le golfe du Saint-Laurent se divisent en deux principales
catégories suivant leur habitat. Il y a les poissons de fond, qui vivent
bien évidemment dans le fond, puis les poissons pélagiques qui, eux, restent
plus près de la surface. Les espèces de poissons de fond pêchées qui sont
les plus connues sont le flétan noir, la merluche blanche, la morue, la plie
canadienne, la plie grise et le sébaste. Quant aux espèces de poissons
pélagiques les plus populaires, il s’agit du capelan, du hareng, du
maquereau, du thon rouge et du requin. Selon les experts, environ deux tiers
des poissons de mer seraient des poissons de fond.
D'abord, tu dois savoir que les différentes espèces de poissons de mer qui
vivent dans le golfe du Saint-Laurent se divisent en deux principales
catégories suivant leur habitat. Il y a les poissons de fond, qui vivent
bien évidemment dans le fond, puis les poissons pélagiques qui, eux, restent
plus près de la surface. Les espèces de poissons de fond pêchées qui sont
les plus connues sont le flétan noir, la merluche blanche, la morue, la plie
canadienne, la plie grise et le sébaste. Quant aux espèces de poissons
pélagiques les plus populaires, il s’agit du capelan, du hareng, du
maquereau, du thon rouge et du requin. Selon les experts, environ deux tiers
des poissons de mer seraient des poissons de fond.
![]() Vraiment? Il y a des requins dans le Saint-Laurent!
Vraiment? Il y a des requins dans le Saint-Laurent!
![]() Oui,
mais ne t’en fais pas, ceux-là sont petits et n’attaquent pas les humains!
Oui,
mais ne t’en fais pas, ceux-là sont petits et n’attaquent pas les humains!
![]() Ouf! Une chance!
Ouf! Une chance!
![]() Maintenant,
laisse-moi te parler d’une autre catégorie d’animaux qui fréquentent le
golfe : les oiseaux marins!
Maintenant,
laisse-moi te parler d’une autre catégorie d’animaux qui fréquentent le
golfe : les oiseaux marins!
![]() Ah
bon! Il y a des oiseaux qui vivent dans l’eau?
Ah
bon! Il y a des oiseaux qui vivent dans l’eau?
![]() Pas
exactement! Les oiseaux ne vivent pas dans l’eau comme les poissons, mais
ils s’y nourrissent et quelques-uns s’y reposent en se laissant flotter à la
surface. Tu sais, comme toi lorsque tu vas à la piscine!
Pas
exactement! Les oiseaux ne vivent pas dans l’eau comme les poissons, mais
ils s’y nourrissent et quelques-uns s’y reposent en se laissant flotter à la
surface. Tu sais, comme toi lorsque tu vas à la piscine!
![]() Ha!
Ha! Ha! Oui! Je vois!
Ha!
Ha! Ha! Oui! Je vois!
![]() Dans
cette catégorie, il existe aussi plusieurs espèces et celles-ci se divisent
en quatre sous-groupes : les oiseaux côtiers, les oiseaux extracôtiers, la
sauvagine et les oiseaux de rivage.
Dans
cette catégorie, il existe aussi plusieurs espèces et celles-ci se divisent
en quatre sous-groupes : les oiseaux côtiers, les oiseaux extracôtiers, la
sauvagine et les oiseaux de rivage.
![]() Qu’est-ce
qui les différencie?
Qu’est-ce
qui les différencie?
![]() Les
oiseaux côtiers, comme les cormorans, les goélands et les fous de Bassan,
dénichent leur nourriture dans les fonds marins ou dans les milieux côtiers,
là où l’eau est peu profonde. Ils ne dorment pas sur l’eau et retournent sur
le sol pour la nuit.
Les
oiseaux côtiers, comme les cormorans, les goélands et les fous de Bassan,
dénichent leur nourriture dans les fonds marins ou dans les milieux côtiers,
là où l’eau est peu profonde. Ils ne dorment pas sur l’eau et retournent sur
le sol pour la nuit.
Grands cormorans

Source : © Rodolph Balej
Fou de Bassan

Source : © Rodolph Balej
Pour leur part, les oiseaux extracôtiers, aussi appelés « oiseaux pélagiques », restent très longtemps en haute mer, ce qui fait qu’ils s’y nourrissent et qu’ils y dorment. Le seul moment où ils retournent sur terre est celui où ils se reproduisent. Les macareux, les petits pingouins et les pétrels font partie de ce sous-groupe.
Macareux moine

Source : © Nelson Boisvert
Dans la classe de la sauvagine, qui regroupe l’ensemble des oiseaux sauvages, 18 espèces différentes fréquentent le golfe. Trois des plus connues sont les bernaches du Canada, les eiders et les macreuses.
Bernaches du Canada

Source : © Rodolph Balej
Finalement, le groupe des oiseaux de rivage, lui, est formé d’oiseaux migrateurs. Ceux-ci font escale dans le golfe pour se ravitailler pendant leur voyage migratoire de l’Arctique à l’Amérique du Sud. Cet arrêt dure habituellement de juillet à septembre. Même si la plupart de ces oiseaux ne restent que peu de temps dans le golfe du Saint-Laurent, certains font leur nid aux alentours. Le bécasseau variable fait partie de cette catégorie.
Bécasseau variable

Source : © Rodolph Balej
![]() Ça
en fait, des espèces qui habitent le golfe!
Ça
en fait, des espèces qui habitent le golfe!
![]() Ça
en fait Oui, et il reste encore une dernière catégorie : celle des
mammifères marins.
Ça
en fait Oui, et il reste encore une dernière catégorie : celle des
mammifères marins.
![]() Est-ce
que c’est la catégorie des baleines?
Est-ce
que c’est la catégorie des baleines?
![]() Tu
as deviné! En fait, la catégorie des mammifères marins comprend deux groupes
: les baleines et les phoques!
Tu
as deviné! En fait, la catégorie des mammifères marins comprend deux groupes
: les baleines et les phoques!
![]() Vraiment?
Il y a aussi des phoques dans le golfe du Saint-Laurent!
Vraiment?
Il y a aussi des phoques dans le golfe du Saint-Laurent!
![]() Eh
oui! Au total, quatre espèces de phoques fréquentent habituellement le golfe
du Saint-Laurent. Deux sont des espèces migratrices, c’est-à-dire qu’elles
viennent passer un certain temps dans le golfe, mais qu’elles n’y restent
pas toute l’année. Il s’agit du phoque du Groenland et du phoque à crète.
Les deux autres, le phoque commun et le phoque gris, habitent le golfe à
l’année. Enfin, il arrive que l’on voie à l’occasion des phoques barbus et
des phoques annelés.
Eh
oui! Au total, quatre espèces de phoques fréquentent habituellement le golfe
du Saint-Laurent. Deux sont des espèces migratrices, c’est-à-dire qu’elles
viennent passer un certain temps dans le golfe, mais qu’elles n’y restent
pas toute l’année. Il s’agit du phoque du Groenland et du phoque à crète.
Les deux autres, le phoque commun et le phoque gris, habitent le golfe à
l’année. Enfin, il arrive que l’on voie à l’occasion des phoques barbus et
des phoques annelés.
Phoque commun

Source : © Rodolph Balej
![]() Et
les baleines?
Et
les baleines?
![]() Cinq
espèces de
baleines à fanons et huit espèces de baleines à dents visitent le
golfe du Saint-Laurent. Les baleines à fanons sont la baleine noire de
l’Atlantique Nord, le petit rorqual, le rorqual à bosse, le rorqual bleu et
le rorqual commun. Les baleines à dents, qui sont carnivores, sont la
baleine à bec commune, le béluga, le dauphin à flancs blancs, le dauphin à
nez blanc, le globicéphale, le grand cachalot, le marsouin commun et
l’orque. Toutefois, seul le béluga habite le golfe toute l’année.
Cinq
espèces de
baleines à fanons et huit espèces de baleines à dents visitent le
golfe du Saint-Laurent. Les baleines à fanons sont la baleine noire de
l’Atlantique Nord, le petit rorqual, le rorqual à bosse, le rorqual bleu et
le rorqual commun. Les baleines à dents, qui sont carnivores, sont la
baleine à bec commune, le béluga, le dauphin à flancs blancs, le dauphin à
nez blanc, le globicéphale, le grand cachalot, le marsouin commun et
l’orque. Toutefois, seul le béluga habite le golfe toute l’année.
Rorqual à bosse

Source : © Rodolph Balej
![]() Il
y en a qui sont carnivores!
Il
y en a qui sont carnivores!
![]() Oui,
mais ne t’en fais pas! Ces animaux ne sont pas considérés comme dangereux
pour l’homme; ils ne mangent que du poisson, du calmar et des crevettes.
Certaines baleines, comme le rorqual bleu, s’alimente presque uniquement de
krill, une sorte de zooplancton.
Oui,
mais ne t’en fais pas! Ces animaux ne sont pas considérés comme dangereux
pour l’homme; ils ne mangent que du poisson, du calmar et des crevettes.
Certaines baleines, comme le rorqual bleu, s’alimente presque uniquement de
krill, une sorte de zooplancton.
![]() Ouf!
Une chance! Alors, eux, où sont-ils dans la chaîne alimentaire? Dis-moi,
tante Mélodie, comment ça fonctionne dans le Saint-Laurent?
Ouf!
Une chance! Alors, eux, où sont-ils dans la chaîne alimentaire? Dis-moi,
tante Mélodie, comment ça fonctionne dans le Saint-Laurent?
![]() Comme
je te l’ai déjà dit, le phytoplancton est à la base de la chaîne
alimentaire. Il sert surtout de nourriture au zooplancton, mais quelques
organismes de la communauté benthique s’en nourrissent également. Après, le
zooplancton devient à son tour le principal aliment de petits poissons
proies comme le capelan, le hareng et le maquereau. Ces derniers servent
ensuite de nourriture aux plus gros poissons comme la morue et le sébaste,
ainsi qu’aux oiseaux et aux mammifères marins, qui sont au sommet de la
chaîne alimentaire. Les mollusques, crustacés et autres organismes de la
communauté benthique, ainsi que le zooplancton, peuvent aussi servir de
nourriture aux animaux du haut de la chaîne.
Comme
je te l’ai déjà dit, le phytoplancton est à la base de la chaîne
alimentaire. Il sert surtout de nourriture au zooplancton, mais quelques
organismes de la communauté benthique s’en nourrissent également. Après, le
zooplancton devient à son tour le principal aliment de petits poissons
proies comme le capelan, le hareng et le maquereau. Ces derniers servent
ensuite de nourriture aux plus gros poissons comme la morue et le sébaste,
ainsi qu’aux oiseaux et aux mammifères marins, qui sont au sommet de la
chaîne alimentaire. Les mollusques, crustacés et autres organismes de la
communauté benthique, ainsi que le zooplancton, peuvent aussi servir de
nourriture aux animaux du haut de la chaîne.
![]() Comme
le rorqual bleu qui ne mange pratiquement que du krill?
Comme
le rorqual bleu qui ne mange pratiquement que du krill?
![]() Oui,
tu as tout compris!
Oui,
tu as tout compris!
![]() C’est
fascinant! Tout semble réglé pour être en harmonie.
C’est
fascinant! Tout semble réglé pour être en harmonie.
![]() Oui!
C’est pourquoi l’humain doit faire attention de ne pas briser ce fragile
équilibre avec ses diverses activités et son mode de vie.
Oui!
C’est pourquoi l’humain doit faire attention de ne pas briser ce fragile
équilibre avec ses diverses activités et son mode de vie.